Il est onze heures du matin, un jour de début décembre. J’ai bu un café, petit-déjeuné de la compote, entamé la lecture du Maître et Marguerite de Boulgakov, lecture dont j’aurais été absolument incapable il y a un an et dont je me félicite aujourd’hui. Je joue un CD de R.E.M, mes draps sont défaits, j’ai du rangement à faire, mes vêtements sont empilés et forment une espèce de grosse montagne, il y a des fleurs fanées sur mon bureau. Il faut absolument que j’arrose mes plantes, l’une d’entre elles est à l’article de la mort, celle que j’aime le plus. Depuis quelques semaines, je ressens quelque chose comme un recommencement. À vrai dire, je l’identifie plus comme un retour, mais ce n’est pas tout à fait vrai, parce qu’il me semble que j’avance à l’aveugle, que je ne sais pas ce que je vais trouver au bout du compte.
Cela fait quelques années que j’ai l’impression d’avoir perdu quelque chose de moi en chemin, quelque chose que j’ai laissé à dessein. À dix neuf ans il ne me restait rien de celle que j’étais à quinze, mais aujourd’hui, l’ordre naturel des choses a été renversé par des retrouvailles tout à fait inattendues avec la littérature. Cette vieille copine un peu naïve avec qui je n’avais plus grand-chose en commun.
Il y a deux ou trois ans, j’étais une espèce de boulet de canon, il me semble que ma vivacité intellectuelle me guidait, j’étais pleine de croyances, enchevêtrées dans la lecture d’essais, de films arts et essais, de rencontres et de soirées où la fête et la politique se côtoyaient. Je déconstruisais ma naïveté catholique, j’avais mille idées pour la manière dont je devais vivre ma vie, je comprenais très bien les liens entre Kant et Marx, Barthes et Susan Sontag. Je me sentais érudite, cool, in, j’avais effacé avec succès d’honteuses années de recherche de validation académique, d’ingénuité romantique, où il m’avait toujours semblé être une try-hard. Ces années, je les ai suffisamment effacées pour qu’aujourd’hui on ne me croie plus quand je les raconte. Et que je ne sache plus vraiment si elles sont arrivées. Les seules preuves que je garde sont des phrases stupides que j’ai prononcées et qui reviennent me hanter, ainsi que le sentiment de satisfaction que j’ai ressenti le jour où je me suis dit que j’avais enterrée cette version de moi-même. Cette nouvelle moi s’accompagnait d’une sorte de nonchalance : je parvenais parfaitement à évaluer ce qui devait me causer du souci, et ce qui devait provoquer mon indifférence en public. Je reniais aisément les deux années de prépa littéraires dont je sortais avec une seule et même phrase : « rétrospectivement je ne sais pas pourquoi j’y suis allée ».
Mais j’ai toujours su pourquoi j’y étais allée (au-delà de l’évidente image du prestige pour laquelle je ne voulais pas avouer avoir succombé) : il était une fois, quelques années plus loin, j’aimais lire des romans, c’était pour moi définitionnel. Après avoir lu les Harry Potter à neuf ou dix ans, j’étais viscéralement tournée vers la poursuite d’un but : devenir Hermione Granger. J’avais le pressentiment qu’elle avait inauguré chez moi la possibilité de ne pas être féminine dans le sens traditionnel de la chose. Toute mon adolescence, lire des romans a fait de moi celle que j’ai reniée plus tard : une nostalgique, une romantique, une perfectionniste, quelqu’un qui voulait, elle aussi, écrire, inventer, quelqu’un qui ne s’interrogeait jamais sur les conditions matérielles car j’avais le privilège de ne pas avoir à le faire, quelqu’un qui voyait dans l’amour une valeur absolue, selon l’enseignement de Jesus Christ et de JK Rowling (quelle ironie, n’est-ce pas), quelqu’un qui pensait pouvoir sauver les gens. Après tout, je viens de l’époque bénie de l’UNICEF et de Malala, où l’on dessine des enfants du monde entier qui se tiennent la main, du Frutiger Aero, des émissions où un adolescent aveugle remporte un concours de chant dans l’émotion générale, cette époque où l’on se sentait si près de vaincre la faim dans le monde, et où les États Unis élisaient le premier président noir de leur histoire.
J’ai déchanté en même temps que le reste du monde, où peut-être ai-je trop projeté sur le monde ce que j’ai vécu comme un changement de paradigme, je ne sais pas. Et j’ai délaissé la fiction, d’une part parce que la prépa littéraire m’en avait globalement dégoutée, mais surtout parce que j’estimais qu’elle ne me donnait aucune arme pour affronter ce nouveau monde. Il me fallait des clefs de compréhension explicites, des faits, des analyses sociologiques et philosophiques plus que tout. Ce n’était plus mignon d’essayer d’être une manic pixie dream girl perdue dans son propre imaginaire. La fiction ne sert à rien, je répétais à qui voulait l’entendre, mais la vérité réside aussi dans le fait que j’étais désormais incapable de lire un roman. Mon temps d’écran aberrant ne tolérait la lecture que lorsqu’elle avait un apport concret, que je pourrais réinjecter quelque part sur internet. J’étais dans un rapport transactionnel à la lecture. Lire de la fiction me faisait perdre du temps; c’était tant mieux si je n’en ressentais pas l’envie.
Début octobre, j’ai retrouvé un chemin vers les romans. Il faut noter que cela s’inscrit pour moi au moment où j’ai commencé à travailler et à la fin d’une situationship. Emportée par le besoin de romantiser le raccourcissement des jours, je me suis plongée dans la littérature anglophone, qui a cela de particulier qu’elle rend plaisante le froid, l’herbe mouillée et les couleurs orangées. Sur les conseils de Tiktok, j’ai enchaîné Les Belles Années de Mademoiselle Brodie (Muriel Spark), la Maison Hantée (Shirley Jackson), Rebecca (Daphné du Maurier) et Ceux qui changent et ceux qui meurent (Barbara Comyns), livres que je conseille vivement au passage. J’ai vite ressenti ce que je veux décrire dans cet article : un retour à quelque chose d’ancien, de sacré. Et quand l’idée a germé de l’écrire, je l’ai envisagé sous le prisme de l’utile : j’avais finalement trouvé l’utilité de la fiction, elle me faisait voyager et me décentrer, explorer les bizarreries de la pensée, ce qui motivait ma propre créativité, j’avais de nouveau envie d’écrire… Mais je pense que cet angle ne serait pas le bon. Je pense qu’avant tout, j’ai retrouvé une part de moi-même anachronique, et que plutôt que de l’évaluer en fonction de son utilité pour moi à présent, il faut que je me concentre précisément sur ce qui m’embête dans cette affaire : j’ai eu tort.
Il y a dans la fiction l’idée d’affronter quelque chose en soi plus pleinement, que dans un essai où le soi fait partie d’un « nous ». Dans la « non-fiction », toute histoire personnelle est absorbée par des dynamiques et des forces globales. Dans la fiction, le mouvement est inverse, tout devient personnel. Il faut y faire face à sa propre crédulité, sa propre émotion, ses propres réflexes, comme si nous y étions. La naïveté que j’avais à treize ans a en partie disparue, j’affronte cette disparition au contact d’histoires qui ne sont pas miennes, je retrouve ce qui reste, et je constate qui n’est plus, on me met face à ce que j’ai laissé partir, ce qui en moi se contredit, ce que je veux reconstruire…
Je me sens plus moi-même depuis quelques semaines que je n’ai l’impression de l’avoir été ces trois ou quatre dernières années, et cette image fragmentée de moi-même me perturbe. Elle m’isole un peu en ce moment, mais je mets cela sur le compte de l’évènement : il se passe quelque chose, là, dans ma vie. C’est abstrait et peut-être incompréhensible, mais tout me paraît méconnaissable, en partant de moi-même. Je ne m’inquiète pas, je me laisse faire : je retrouve qui reste, je constate qui n’est plus, ce que je veux reconstruire.
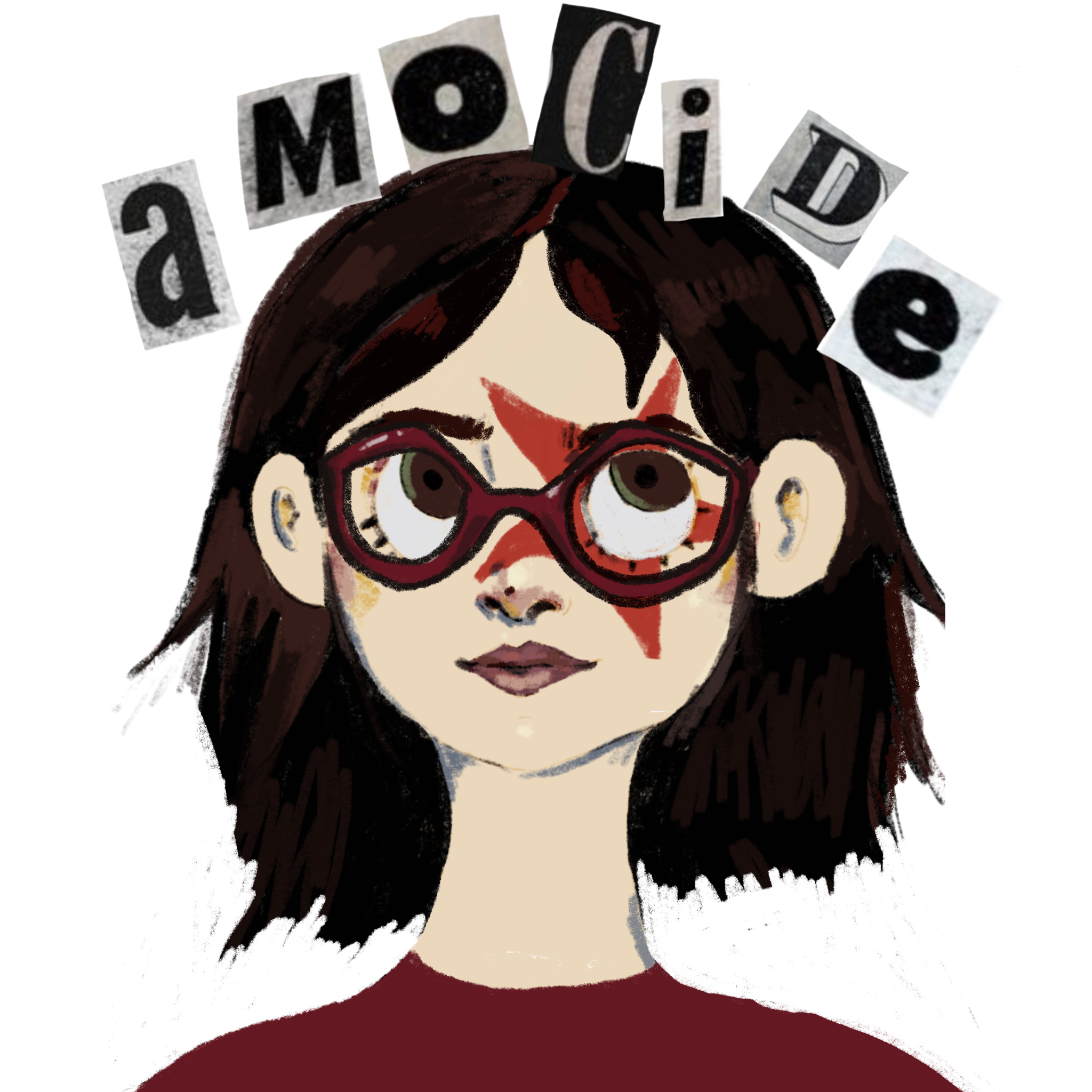

Laisser un commentaire